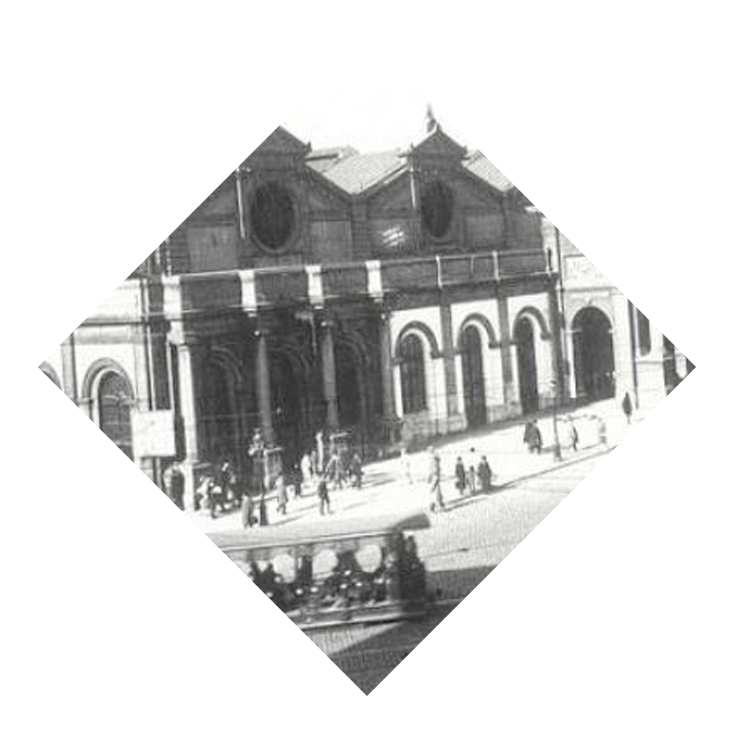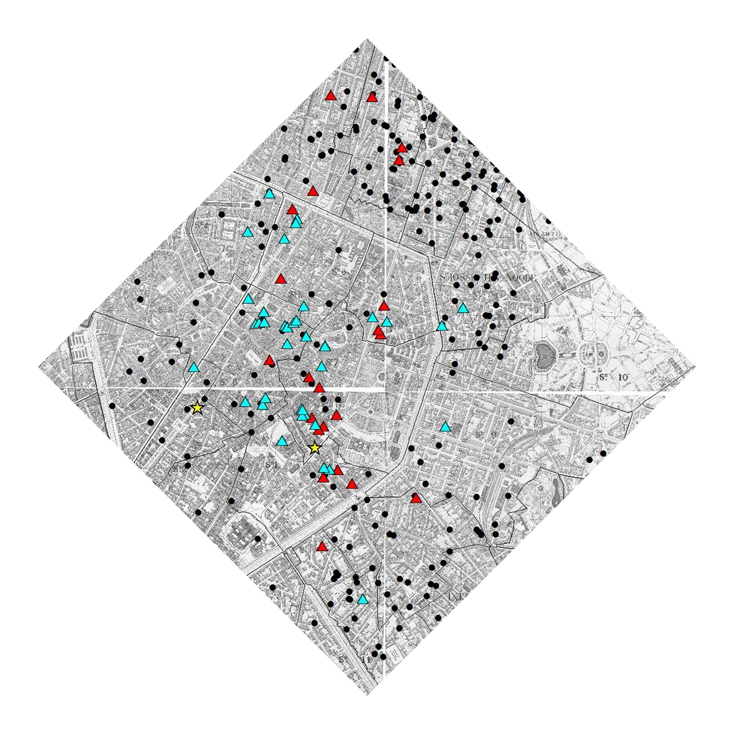Les peintres animaliers belges ont souvent utilisé l’image de l’animal comme une manière de symboliser les réalités sociales humaines. Dans son étude sur Les peintres animaliers belges (1911), le romancier naturaliste Georges Eekhoud (1854-1927) insiste sur le choix qu’ils ont souvent fait de représenter des animaux « populaires », des vaches plutôt que des chevaux de monte, des chiens errants plutôt que des lévriers aristocratiques, des animaux de cirque suivant de misérables saltimbanques plutôt que de pimpants carlins. Avec Bruxelles le matin, Joseph Stevens (1816-1892) en donne l’illustration exemplaire. Voici en quels termes le romancier commente ce tableau :
« Stevens peignit aussi le zinneke comme l’appelle le langage populaire et dont [Georges Garnir] a raconté les odyssées, l’infortuné souffre-douleur, estropié ou valétudinaire, mal noyé par les gavroches ou arraché pour son malheur au plongeon suprême, le triste et débonnaire batteur de pavé, abandonné de tous, l’échine meurtrie de coups de pieds, le vagabond errant, le poil souillé, traité comme un pestiféré ou comme un enragé. » (Georges Eekhoud, Les peintres animaliers belges, Bruxelles, G. Van Oest et Cie, 1911, p. 40.)
Les chiens de Stevens représentent l’errance, la pauvreté, l’exclusion sociale. Leurs bandes parcourent la ville comme un no man’s land. Mais ils sont chassés des quartiers riches tandis que les zones industrielles ou les friches leur accordent l’asile. Ils se répartissent donc inégalement dans la ville.
Pour le même Georges Eekhoud, comme pour plusieurs artistes d’origine bourgeoise en quête de différence, l’exploration des quartiers populaires est une tentation puissante. Il est attiré par les populations des quartiers pauvres et spécialement par les bandes de jeunes voyous qui condensent sa rêverie homosexuelle. Dans Voyous de velours (1904), le narrateur Laurent Paridael suit ses jeunes amis marolliens dans leurs démonstrations gymniques, qui lui permettent d’entrevoir les beaux corps nus, masculins et populaires qu’il affectionne :
« Représentez-vous, au fond d’un étroit boyau du quartier des Marolles, ironiquement appelé rue de la Philanthropie, un assez vaste hangar, ancien atelier de charron ou magasin de chiffonniers, dans lequel on pénètre par un bouge ne différant des autres taudis de la ruelle que par les photographies des célébrités foraines accrochées aux parois. Sur la lice jonchée de tan et de sciure de bois, dont l’odeur résineuse se mêle à celle des émanations humaines, s’éparpillent les haltères et des poids. À travers la buée opaque et rousse, à peine combattue par une fumeuse lampe à pétrole, je démêle les habitués de l’endroit, des apprentis pour la plupart, venus en grand nombre à cause du samedi soir. Dans les coins, j’en vois qui se déshabillent avec de jolis gestes frileux : ils sortent de leurs nippes comme papillons de leurs chrysalides, et le ton laiteux de leur chair fait songer à des cuisses de noix extraites de leur coquille. Il y en a de nus jusqu’à la ceinture ; d’autres ne gardent que le caleçon traditionnel. La plupart se trémoussent et batifolent dans une mêlée confuse. Leurs enchevêtrements suggèrent les ébats de jeunes chiens qui se mordillent et se reniflent. Ils s’abandonnent à la volupté du mouvement ; ils se réjouissent du ressort de leurs muscles ; ils ne savent, dirait-on à quels tortillements se livrer pour assouvir leur fringale d’activité ; ils s’empoignent et se manient au hasard comme de vivants engins de gymnastique. Et avec les haleines et les sueurs, l’atmosphère s’enfièvre aussi de rires, de défis et d’appels. » (Georges Eekhoud, Voyous de velours ou l’autre vue, Bruxelles, Éditions Labor, coll. Espace Nord, 1991 [1926], p. 65.)
La conscience aiguë de l’inscription des frontières sociales dans le cadre urbain aboutit dès lors à une magnifique description du panorama de la ville basse :
« Il m’arrivait, il y a quinze jours, de contempler le panorama dont on jouit de ce plateau que domine le palais de justice de Bruxelles surplombant de sa masse la grouilleuse ville basse, la cité par excellence de notre cattiva gente. Accoudé à la balustrade, j’embrassais l’immensité de la perspective suburbaine. Par-delà le fouillis de ruelles et de culs-de-sac, je goûtai cet horizon houleux fouetté par un vent sadique, qui faisait fuir les nuées sanguinolentes comme la panique échevelée des ribaudes et des colporteuses devant la meute des argousins. Ce qui se passait dans le ciel me fit songer à l’atmosphère de terrorisme et de contravention habituelle à ces sentines s’entrecroisant à mes pieds. Sous l’impression de cette synesthésie, je dévalai la rampe à lacets aboutissant à un carrefour formé par les rues de l’Épée, des Minimes et Notre-Dame-de-Grâce. Arrivé au bas, je tombai sur un groupe d’une demi-douzaine de gueux renforcés, au cachet local et loqueteux, des voyous de grand style enfin. Ils portaient leur vêture dérisoire avec ce dégingandement et ce débraillé qui leurs siéent si bien, et dont je raffole. » (Georges Eekhoud, Voyous de velours ou l’autre vue, Op. cit., p. 43.)
Cent ans plus tard, non sans ironie, le dramaturge Richard Kalisz (1945-) raconte lui aussi une scène de drague homosexuelle. Celle-ci s’est déplacée dans le parc du Cinquantenaire. Mais elle s’achève sur une désillusion, l’homme rencontré brièvement se révèle un vrai voyou, qui dérobe le portefeuille du narrateur :
« Habillés de blue jeans, l’uniforme des rébellions d’autrefois, ils ont les traits de la mode, sans caractère qui leur soit propre, sans se doter des codes d’une société secrète ou marginale qui, hier encore, pouvait fasciner les artistes et inspirer des œuvres brûlantes.
« Maintenant, lui , il sourit, de manière franche et ouverte. Dois-je concevoir qu’on peut ainsi masquer des arrière-pensées ? Non. Mon trouble sexuel ne peut me rendre aveugle à ce point. À ce niveau, je distingue encore le vrai du faux. Et pourtant… […] De sa main, il frôle ma braguette, caressant ensuite le sexe au travers du tissu. Le parc et l’esplanade ont connu cet événement des millions de fois sans en être ébranlés. Je réponds pareil, tout en remontant vers son ventre et ses épaules. Il ne bande pas, mais je n’y prête aucune attention, parce qu’il me capte par la parole :
– J’aime être dominé.
Mon trouble augmente. Pourtant, ce n’est pas la première fois que je reçois ce genre de demande.
– C’est bien, moi, j’aime dominer. […]
Alors, d’un mouvement rapide, je passe ma veste sur les deux épaules, et il se serre plus violemment contre moi. Où tient-il ses bras ? Mais je perçois qu’il rajuste ma veste à l’épaule gauche. Et comme j’accompagne sa sollicitude d’un mouvement de tête, il ajoute immédiatement :
– Ta veste.
Je comprends qu’il sous-entend : « elle allait tomber ». Ce ne peut être que dans cet intervalle de quelques secondes, dans cette brève affection feinte, qu’il a pu glisser sa main dans la poche intérieure et tout subtiliser : carnet de chèques et portefeuille. » (Dictionnaire de Bruxelles – Définitions d’une ville par les gens qui y vivent, y passent ou y travaillent, Bruxelles, Éditions Labor & Maison de la Francité, 2000, pp. 100-101.)
L’expérience privée de la sexualité transgressive rejoint ainsi l’expérience sociale des frontières invisibles de la ville.
Paul Aron