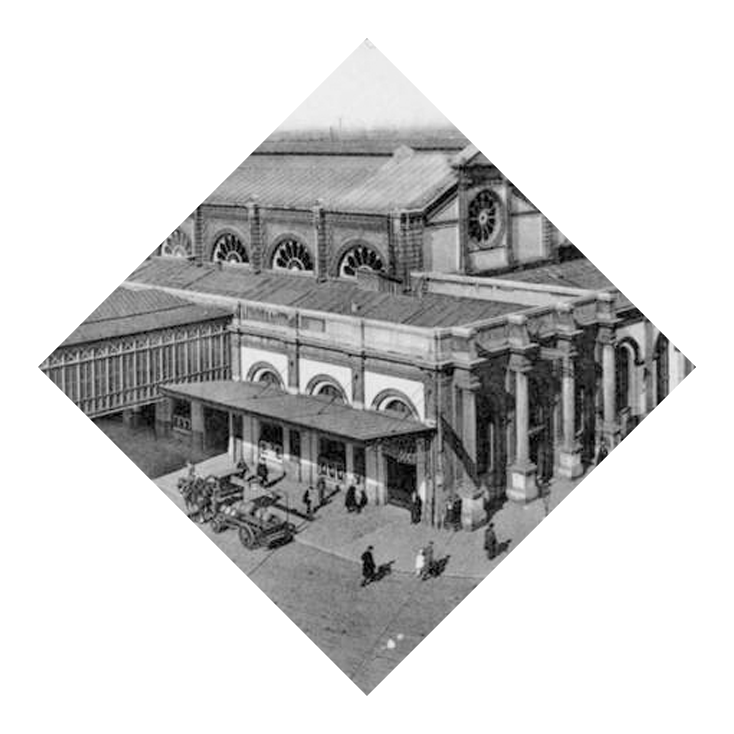À l’extrémité de l’avenue Louise la plus proche du bois de la Cambre, s’élève une petite fontaine accompagnée d’un banc. La pureté des vers qui y figurent (sur le banc « Qui m’écoute chanter me garde de mourir » ; sur la vasque « Je t’offre un verre d’eau glacée / N’y touche pas distraitement / Il est le prix d’une pensée / Sans ornement ») évoque le souvenir du poète Odilon-Jean Périer (1901-1928), mais également celui de cette avenue qui a su l’inspirer dans son ultime moment de grâce.
Au mois de janvier 1924, Odilon-Jean Périer rédige Le Citadin. Poème ou Éloge de Bruxelles, véritable ode à la capitale, et plus particulièrement aux environs de l’avenue Louise que le poète connaît bien pour y résider. Réalisée au XIXe siècle en raison du manque de « promenades » à Bruxelles, l’avenue Louise ne connaîtra, qu’à partir de 1930, les changements significatifs dus à la domination progressive de l’automobile et des immeubles collectifs. Ainsi, à l’époque de Périer, l’avenue Louise demeure un tracé agréable, arboré, favorable aux piétons, majoritairement résidentiel, composé principalement d’hôtels de maître. Située à l’entrée du bois de la Cambre, elle est cette douce promenade transitoire entre le silence de la nature et le charme de la ville bourgeoise. En effet, Périer parcourt l’avenue comme s’il traversait un jardin familier :
Terrasse des cafés sous un lierre vermeil
D’où je vois s’agiter ma ville industrieuse,
Boulevard aussi beau par ta robe poudreuse
Qu’un fleuve déployé dans son vaste dessin,
Maisons de mes amis, la mienne, mon jardin,
Champs d’avoine et d’air pur qui faites la banlieue,
Nuages sur les toits et dans la pierre bleue,
Vous êtes le décor que je donne à ces vers.
Odilon-Jean Périer, Poèmes, Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1979, p. 129.
Les terrasses sont habillées de lierre, la ville est « industrieuse » non industrielle, le boulevard devient cours d’eau. Ainsi, le poète déploie sa marche urbaine dans un décor impressionniste et métaphorique où la ville se fait finalement naturelle. Cette marche ne relève pas de la flânerie, mais bien de la promenade régulière entre la place Stéphanie, la Porte de Namur, les Jardins du Roi et le bois de la Cambre, tant de lieux à proximité de l’avenue de la reine. En effet, Périer sait où il va, il connaît sa ville : « J’avance » […] « Ce n’est pas au hasard que je nomme ses dieux / Et ni distraitement que ce grand corps murmure ». Or selon Rebecca Solnit, la marche est idéalement « un état où l’esprit, le corps et le monde se répondent », permettant de réinvestir l’espace de sens, de se l’approprier et de le réagencer. La promenade élogieuse de Périer devient dès lors une sublimation de la ville, grâce à l’inscription des vers dans le quartier nanti et arboré de l’avenue Louise, métonymie du Bruxelles promis dans l’intitulé. Ainsi Périer réinvente la ville par le prisme d’une géographie personnelle et bourgeoise, mais également par une marche poétique redéfinie par le genre de l’éloge : chaque pas dans la ville devenant une célébration de celle-ci, célébration permise par la transfiguration de Bruxelles (et sa limitation aux environs de l’avenue Louise) en un espace naturel et familier.
Pour le poète, la promenade devient dès lors activité de création poétique, et non plus seulement de loisir. Les vers inscrits sur la fontaine et sur le banc sont les vestiges de cette création.
Mélanie de Montpellier
Pour en savoir plus :
Rebecca Solnit, L’Art de marcher, Paris, Actes Sud, 2002.
Paul Aron, « L’avenue Louise et les écrivains », Textyles [En ligne], 47 | 2015, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 28 février 2017. URL : http://textyles.revues.org/2635